Antagonistes des récepteurs de l’angiotensine II : indications, effets secondaires

Les antagonistes des récepteurs de l’angiotensine II sont une classe thérapeutique spécifique. Ils regroupent différentes molécules dont l’action repose sur une inhibition de l’angiotensine II. Dans l’organisme, ils procurent des effets semblables à ceux des IEC (inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine).
À l’opposé de ces traitements, ils ont l’avantage de présenter une forte tolérance et moins d’effets secondaires. Par conséquent, on les utilise de plus en plus pour pallier plusieurs pathologies courantes. Il y a notamment, l’hypertension artérielle, l’insuffisance rénale et certains troubles cardiaques.
Antagonistes des récepteurs de l’angiotensine II (SARTANS) : présentation
Les antagonistes des récepteurs de l’angiotensine II sont des médicaments capables de bloquer l’activité de l’angiotensine II. Ils sont également connus sous les appellations « SARTANS » et « ARAII » et agissent sur les récepteurs centraux de l’angiotensine. On les utilise en médecine moderne pour le traitement de plusieurs maladies communes.
L’angiotensine est un peptide appartenant au système « rénine-angiotensine-aldostérone » retrouvé au niveau du rein. Elle s’exprime à plusieurs niveaux dans l’organisme et intervient dans les processus physiologiques de régulation de la tension artérielle. Elle possède d’importantes propriétés vasoconstrictrices et provoque une rétention de sodium et d’eau. On la retrouve sous deux formes biologiques : l’angiotensine I et l’angiotensine II.
L’angiotensine II est la forme active de l’angiotensine. C’est elle qui accomplit la quasi-totalité des fonctions physiologiques qu’on associe à l’angiotensine. Elle provient de la fragmentation de l’angiotensine I par l’enzyme de conversion de l’angiotensine (ECA). Elle se fixe, dans l’organisme, à deux récepteurs spécifiques : les récepteurs AT1 et les récepteurs AT2.
Les antagonistes des récepteurs de l’angiotensine II entrent en compétition avec les récepteurs AT1 de l’angiotensine II. Ils provoquent une faible captation de l’angiotensine II et induisent donc une diminution de son activité. Ils procurent, ainsi, des effets semblables aux effets des inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine. À la différence de ces molécules, toutefois, ils n’ont aucun impact sur la production de l’angiotensine II.
Les antagonistes des récepteurs de l’angiotensine II et les inhibiteurs de l’enzyme de conversion sont tous efficaces. Cependant, à l’opposé des IEC, les SARTANS ont démontré une meilleure tolérance. Ils présentent moins d’effets secondaires que ceux-ci et constituent, de ce fait, une avancée thérapeutique considérable. Ils représentent un parfait traitement substitutif pour les patients sous IEC qui présentent une toux gênante et des éruptions cutanées.
Antagonistes des récepteurs de l’angiotensine II (SARTANS) : indications
Les antagonistes des récepteurs de l’angiotensine II présentent plusieurs indications. Il y a principalement :
- L’hypertension artérielle ;
- L’infarctus du myocarde ;
- L’insuffisance cardiaque ;
- La néphropathie diabétique.
Beaucoup plus rarement, ils entrent en ligne de compte dans la prise en charge de l’athérosclérose sévère.
Hypertension artérielle
L’hypertension artérielle est une maladie chronique caractérisée par une vasoconstriction importante et une hausse de la pression artérielle. Elle survient fréquemment chez les personnes de plus de 60 ans et affecte principalement les femmes. Dans la plupart des cas, elle est asymptomatique. Toutefois, il peut arriver qu’elle se manifeste par des symptômes peu spécifiques tels que :
- Les céphalées sévères ;
- L’essoufflement ;
- L’anxiété ;
- Les saignements de nez ;
- Les sensations de pulsations sur la tête et dans le cou.
Les causes précises de survenue d’une hypertension artérielle sont encore méconnues. On sait, cependant, que les mécanismes à l’origine du déclenchement de la maladie font intervenir plusieurs facteurs. Il y a les facteurs comportementaux (alcoolisme, mauvaise alimentation), les facteurs génétiques (antécédents familiaux) et les facteurs médicaux.
La prise en charge de l’hypertension artérielle passe par la correction des facteurs de risque et une médication. Les médicaments utilisés varient et comprennent presque toujours un vasodilatateur, un antagoniste des récepteurs de l’angiotensine II par exemple. En l’absence d’une prise en charge adéquate, l’hypertension artérielle évolue généralement vers des cardiopathies graves. C’est d’ailleurs, un facteur de risque majeur des troubles cardiovasculaires. Outre les cardiopathies, elle peut également se compliquer en lésions rénales et oculaires graves.
Infarctus du myocarde
L’infarctus du myocarde communément appelé crise cardiaque correspond à une nécrose, c’est-à-dire une mort des cellules myocardiques. Il concerne généralement une région, plus ou moins vaste, du myocarde et fait suite au défaut d’irrigation du cœur. Habituellement, il survient chez les personnes du troisième âge et affecte principalement les hommes.
Le tableau clinique d’un infarctus du myocarde est dense et varie souvent d’un patient à l’autre. Dans certains cas, il se manifeste par des symptômes variés incluant une douleur thoracique écrasante, un essoufflement et des étourdissements. Dans d’autres cas, en revanche, la maladie survient brusquement et entraîne un arrêt cardiaque soudain.
La principale cause de survenue d’un infarctus du myocarde est l’athérosclérose. Il s’agit d’une condition pathologique caractérisée par la formation de plaque d’athérome à l’intérieur des artères. Outre l’athérosclérose, d’autres conditions pathologiques sont favorables à la survenue d’un infarctus du myocarde. Il y a :
- L’hypertension artérielle ;
- Le diabète ;
- L’obésité ;
- Le stress chronique ;
- Les maladies cardiaques.
La maladie présente également une composante génétique et affecte plus fréquemment les personnes ayant des antécédents familiaux de crises cardiaques.
Le traitement de première intention de l’infarctus du myocarde repose sur une oxygénation et une décoagulation du sang. Généralement, on le couple à un traitement de soutien ayant pour but de diminuer la pression cardiaque. Les médicaments utilisés dans le cadre du traitement de soutien sont multiples. Ils incluent souvent un vasodilatateur comme les antagonistes des récepteurs de l’antagoniste II.
En l’absence d’un traitement adéquat, l’infarctus du myocarde induit des complications graves conditionnant le pronostic vital. Il y a par exemple les arythmies (tachycardies sévères) et le choc cardiogénique qui traduit une altération de la fonction contractile des muscles cardiaques. Beaucoup plus rarement, l’infarctus du myocarde peut causer une déchirure des muscles, des valves et des parois du cœur. On parle alors d’une rupture cardiaque.
Insuffisance cardiaque
L’insuffisance cardiaque est une cardiopathie chronique caractérisée par l’altération de la fonction de pompe du cœur. Elle concerne principalement les femmes et survient généralement à un âge supérieur à 60 ans. Elle évolue par des accès d’intensité variés et peut causer au long terme un infarctus du myocarde.
Les manifestations d’une insuffisance cardiaque sont multiples et très diversifiées. Elles comprennent principalement :
- Une congestion pulmonaire ;
- Une rétention d’eau dans l’organisme ;
- Une irrigation imparfaite des organes vitaux ;
- Une tachycardie ;
- Une difficulté à respirer ;
- Des étourdissements.
Plus rarement, la maladie peut entraîner un gain de poids important, des douleurs thoraciques et des troubles de sudation.
Les étiologies exactes d’une insuffisance cardiaque n’ont pu être entièrement élucidées. On sait, toutefois, que la maladie survient généralement en présence de certaines pathologies. Il s’agit, principalement, de la maladie coronarienne, de la crise cardiaque, du surmenage cardiaque et de l’ethnicité. Ces maladies induisent souvent un rétrécissement des vaisseaux sanguins à l’origine d’une modification de la fonction de pompe cardiaque.
Pour le traitement de l’insuffisance cardiaque, on utilise généralement les médicaments capables d’induire une vasodilatation comme les SARTANS. Outre ceux-ci, le médecin traitant peut également décider de mettre le patient sous un bêtabloquant ou un diurétique. Par ailleurs, pour optimiser l’effet des traitements, on prescrit parfois des mesures hygiéno-diététiques spécifiques au patient.
L’insuffisance cardiaque n’a aucun impact sur le pronostic vital si on la traite convenablement. En revanche, en l’absence d’un traitement, elle peut entraîner des complications graves. Par exemple, les lésions cardiaques, les lésions rénales, les problèmes de valves cardiaques et les arythmies.
Néphropathie diabétique
La néphropathie diabétique ou l’insuffisance rénale du diabétique survient fréquemment en cas de diabète. Elle traduit une altération de la fonction rénale et entraîne des modifications dans la miction. Elle concerne principalement les hommes, les personnes se trouvant dans la cinquantaine et elle évolue sur plusieurs années.
Les symptômes caractéristiques d’une néphropathie diabétique sont nombreux. Ils incluent généralement :
- Les nausées et les vomissements ;
- La faiblesse musculaire ;
- La perte d’appétit ;
- Les problèmes de sommeil ;
- La réduction de la quantité d’urine éjectée ;
- La baisse de l’acuité mentale ;
- Les œdèmes des chevilles et des pieds.
La maladie provoque dans certains cas rares des contractions et crampes musculaires ainsi que des démangeaisons persistantes. Le diabète est la principale raison de survenue d’une néphropathie diabétique. Il provoque une importante accumulation de sucre dans le sang et induit plusieurs modifications vasculaires. Ces dernières épuisent les reins et au long court, ils se trouvent dans l’incapacité d’accomplir correctement leurs fonctions.
Pour la prise en charge de la néphropathie diabétique, en plus des traitements classiques du diabète, on recourt à d’autres médicaments. C’est le cas, par exemple, des antagonistes des récepteurs de l’angiotensine II ou d’autres vasodilatateurs. Ces médicaments permettent une réduction des effets vasculaires causés par le diabète.
Sur le long terme, une néphropathie diabétique non traitée peut évoluer vers des complications sévères. Les plus redoutées comprennent une insuffisance rénale chronique et une rétention hydrique chronique. Beaucoup plus rarement, la maladie peut aussi induire une diminution de la réponse immunitaire et une baisse de la libido.
Antagonistes des récepteurs de l’angiotensine II (SARTANS) : contre-indications
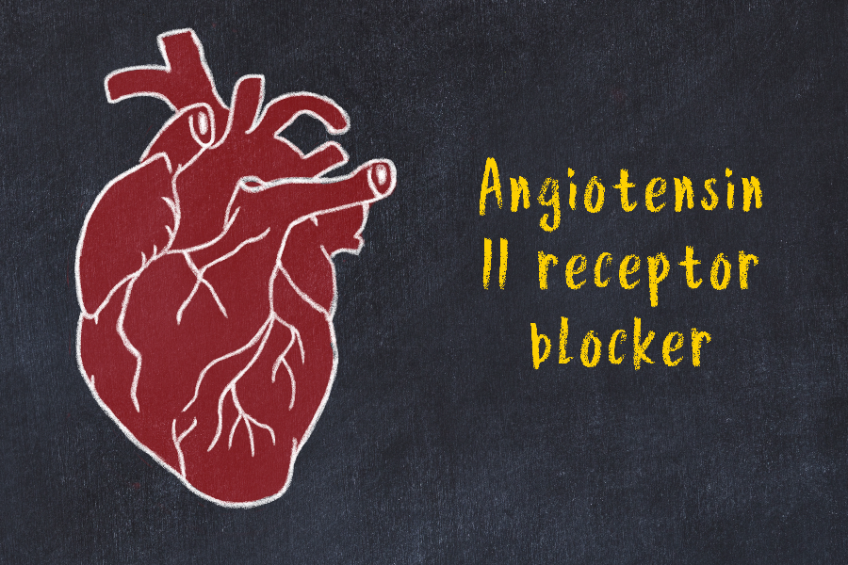
À l’instar de tout médicament, les antagonistes des récepteurs de l’angiotensine II font l’objet de plusieurs contre-indications. Ces dernières concernent des conditions physiologiques et pathologiques spécifiques.
Grossesse
D’après plusieurs études, l’utilisation des antagonistes des récepteurs de l’angiotensine II durant la grossesse peut avoir d’importantes répercussions sur le fœtus. Elle peut causer des malformations crâniofaciales et des malformations de certains membres du fœtus. De même, elle induit dans certains cas un défaut important d’ossification de la voûte crânienne. Pour ces raisons, à l’instar des IEC, on contre-indique l’usage des SARTANS durant la grossesse.
Allaitement
Au même titre que la grossesse, l’allaitement constitue une contre-indication aux antagonistes des récepteurs de l’angiotensine II. En effet, les SARTANS sont des molécules qui peuvent passer du sang au lait maternel. Elles peuvent donc induire chez le nourrisson une panoplie d’affections graves.
Sténoses bilatérales des artères rénales
Par un mécanisme non élucidé, les antagonistes des récepteurs de l’angiotensine II provoquent une exacerbation des manifestations de certaines pathologies. C’est le cas, par exemple, des sténoses bilatérales des artères rénales qui constituent une contre-indication aux antagonistes des récepteurs de l’angiotensine II.
L’insuffisance hépatique sévère
L’insuffisance hépatique sévère constitue comme les sténoses bilatérales des artères rénales une contre-indication aux SARTANS. En effet, les SARTANS exposent l’insuffisant hépatique à un risque important de décompensation et d’hépatite médicamenteuse.
Antagonistes des récepteurs de l’angiotensine II (SARTANS) : effets secondaires
Les antagonistes des récepteurs de l’angiotensine II présentent plusieurs effets secondaires. Ces derniers sont répartis en deux groupes. Ainsi, on distingue les effets secondaires fréquents et les effets secondaires rares des antagonistes des récepteurs de l’angiotensine II.
Effets secondaires fréquents des antagonistes des récepteurs de l’angiotensine II
Les effets secondaires fréquents des antagonistes des récepteurs de l’angiotensine II comprennent principalement :
- Une insuffisance rénale fonctionnelle ;
- Une hypotension artérielle ;
- Une hyperkaliémie (hausse du taux de potassium sanguin) ;
- Une anémie ;
- Des éruptions cutanées mineures ;
- Une diarrhée.
Outre les effets secondaires susmentionnés, les SARTANS entraînent aussi des étourdissements, des vertiges et des douleurs abdominales. Beaucoup de patients sous SARTANS se sont également plaints de troubles de sommeil, de palpitations, de mal de tête et de constipation.
Effets secondaires rares des antagonistes des récepteurs de l’angiotensine II
Les effets secondaires rares des antagonistes des récepteurs de l’angiotensine II regroupent essentiellement :
- Les douleurs articulaires ;
- Les bourdonnements d’oreilles ;
- Les troubles de l’érection ;
- La dépression ;
- La hausse des taux de transaminases ;
- L’hépatite ;
- La formation d’un œdème de Quincke.
Ces effets indésirables surviennent rarement. Sur dix patients utilisant un ARAII, on estime qu’ils concernent au plus un patient. Les patients concernés par ces effets doivent informer un professionnel de santé en vue de prendre un avis médical. Autrement, ils s’exposent à des pathologies graves susceptibles d’entraîner une aggravation de la maladie traitée.
Antagonistes des récepteurs de l’angiotensine II (SARTANS) : principaux représentants
Les antagonistes des récepteurs de l’angiotensine II disponibles sur le marché sont nombreux. On les répartit en plusieurs groupes selon leurs structures. Il s’agit des biphényles dérivés de tétrazole, des nebifenilovyes dérivés de tétrazole, des netetrazols nebifenilovy et des composés non cycliques.
Les principaux antagonistes des récepteurs de l’angiotensine II toutes classes confondues sont :
- Le Losartan ;
- L’Eprosartan ;
- L’Irbesartan ;
- Le Telmisartan ;
- Le Valsartan ;
- Le Candésartan.
Ces antagonistes des récepteurs de l’angiotensine II présentent plusieurs différences moléculaires. Ils comprennent des principes actifs et des excipients variés. De même, on les prend à des posologies distinctes. C’est le médecin traitant qui se charge généralement de les définir en considérant les caractéristiques du patient.




