Toxoplasmose et Grossesse : Causes, Symptômes, Diagnostic, Traitement

La toxoplasmose est une maladie considérée pour la plupart du temps comme banale, voire bénigne. Mais elle peut se révéler très dangereuse lorsqu’une femme en état de grossesse l’attrape. D’une manière naturelle, la grossesse est une période à risque aussi bien pour la mère que pour le bébé. Voilà pourquoi, il est important de connaître toutes les informations sur la toxoplasmose afin de s’en prémunir.
Pour ce faire, cet article vous fournit tous les détails sur la toxoplasmose. Vous y découvrirez sa définition, les causes et facteurs qui en sont les vecteurs, les symptômes présentés et les complications auxquelles elle expose la femme pendant la grossesse.
Vous y trouverez aussi les méthodes de dépistage, les moyens de traitement efficace et adéquat de la toxoplasmose en cas de grossesse. Pour finir, vous découvrirez les conseils essentiels et simples pour éviter la toxoplasmose pendant la grossesse.
La toxoplasmose : définition, causes et facteurs de risque chez une femme enceinte
La toxoplasmose, à l’instar des autres maladies, est aussi une altération, une dégradation de quelque chose ou un trouble de l’organisme. C’est la raison pour laquelle il faut la connaître de façon spécifique.
Définition
La toxoplasmose est une maladie qui résulte d’une infection par le parasite appelé toxoplasma gondii. En effet, le toxoplasma gondii est une espèce de parasites intracellulaires appartenant au phylum des Apicomplexa.
La toxoplasmose est une zoonose, c’est-à-dire une infection transmise par les animaux dont les pathogènes en cause peuvent être des bactéries, des virus ou des parasites.
Causes et facteurs de la toxoplasmose
La toxoplasmose est une maladie d’origine animale. Elle est due à une infection par un parasite microscopique, le toxoplasma gondii. Ce parasite infecte le plus souvent des animaux à sang chaud dont l’hôte définitif est un félidé : le chat.
En effet, le chat s’infeste en mangeant des souris ou des oiseaux dans lesquels le parasite est déjà présent en forme de kystes contenant jusqu’à 300 toxoplasmes. Le toxoplasme peut se trouver aussi dans les muscles de nombreux animaux de boucherie.
Par conséquent, la toxoplasmose peut se trouver dans les excréments des chats, mais aussi dans des aliments contaminés. Les herbivores comme les moutons, les porcs qui broutent au ras du sol souillé, des crottes de chat sont les plus atteints. Plusieurs autres facteurs favorisent la contamination de la toxoplasmose :
- La consommation de la viande mal cuite;
- Le contact avec des couverts et autres ustensiles non lavés et ayant touché la viande;
- La consommation des fruits et légumes malpropres et des produits non pasteurisés tels que le lait, le camembert.
La toxoplasmose est à l’origine de séquelles importantes chez le fœtus lorsqu’elle est contractée par une femme en état de grossesse. D’une personne à une autre, elle peut se manifester de diverses manières.
Symptômes et complications de la toxoplasmose pendant la grossesse
La toxoplasmose, à l’instar des autres maladies, déclenche une alerte organique qui se manifeste sous maintes formes selon les cas. Dans le cas d’une femme en état de grossesse, l’alerte peut apparaître d’une manière encore plus grave.
Symptômes
En général, dans 60 % des cas, la toxoplasmose parait asymptomatique. Les signes éventuels sont bénins et peu spécifiques parce qu’elle déclenche plusieurs symptômes similaires à ceux de plusieurs maladies. Les symptômes de la toxoplasmose peuvent se regrouper en 3 catégories.
Chez les personnes en bonne santé
Chez les personnes en bonne santé, la toxoplasmose provoque les symptômes tels que :
- Fièvre légère ;
- Douleurs musculaires ;
- Fatigue ;
- Ganglions enflés.
Ces symptômes ne durent que peu de temps avant de disparaître.
Chez les personnes immunodéprimées (celles dont le système immunitaire est fragilisé)
Chez les personnes immunodéprimées, c’est-à-dire celles dont le système immunitaire est fragilisé, la toxoplasmose apparaît avec des symptômes neurologiques sévères ou graves, à savoir :
- Convulsions ;
- Pneumonie.
Chez la femme en état de grossesse et le fœtus
La toxoplasmose est dangereuse chez la femme enceinte, avec des manifestations telles que :
- Fièvre modérée inférieure à 38 °C ;
- Présence des ganglions de façon particulière au cou et à la base du crâne ;
- Éruption cutanée sur tout le corps ;
- Fatigue qui dure pour la plupart des semaines ou des mois ;
- Mal de tête ;
- Douleurs et courbatures dans les articulations et les muscles.
Ces alertes ne sont pas sans conséquence néfastes sur le fœtus. La toxoplasmose peut provoquer des troubles à la naissance. Le fœtus est aussi susceptible d’avoir des lésions oculaires ou neurologiques assez graves.
L’infection est d’autant plus sévère lorsqu’elle survient en début de grossesse. Elle peut exposer le fœtus à d’importantes anomalies du développement. La toxoplasmose pourrait dans le cas extrême provoquer une fausse couche.
Par ailleurs, le parasite traverse le placenta si la contamination a lieu à un moment avancé de la grossesse. Ainsi, le bébé peut :
- Souffrir des troubles du développement des yeux ;
- Présenter une jaunisse ;
- Avoir une augmentation de la rate et du foie ;
- Avoir des convulsions.
Complications de la toxoplasmose pendant la grossesse
Les risques de la toxoplasmose sont relatifs selon le stade de la grossesse. Si une femme enceinte attrape la toxoplasmose, elle pourra transmettre l’infection au fœtus. Cela peut conduire à une maladie toxoplasme chez le fœtus.
En revanche, il faut reconnaître que l’infection fœtale n’est pas toujours grave. Sa sévérité dépend du nombre et de la virulence des parasites transmis. De même, l’immaturité immunitaire du fœtus l’expose davantage. L’âge fœtal est donc un facteur fondamental. En effet, plus le toxoplasme est transmis tard, moins les lésions sont graves.
- Lorsque l’infection est antérieure à la conception de plus de 6 mois, il ne peut y avoir de risque de toxoplasmose congénitale ;
- Lorsque l’infection de la mère s’est produite dans les semaines ayant précédé la conception ou avant la 10esemaine d’aménorrhée, le risque de contamination fœtale reste faible. En revanche, lorsque les lésions existent, elles sont graves ;
- Lorsque l’infection maternelle se produit entre les 10e et 16esemaines, le risque de toxoplasmose congénitale est maximal ;
- Si les infections maternelles surviennent après la 16esemaine, le risque de transmission de toxoplasmose est aussi maximal.
À ce stade, il est clair que la maturation immunitaire du fœtus a progressé. Alors, les infections congénitales sont bénignes. Toutefois, les enfants doivent être traités.
Au nombre des risques et complications potentiels pour l’embryon et le fœtus, nous avons :
- Hydrocéphalie ;
- Retard mental ;
- Calcifications intracrâniennes ;
- Choriorétinite ;
- Ictère, qui peut parfois atteindre presque tous les organes ;
- Un avortement tardif et une mort fœtale in utero possibles.
Compte tenu des risques élevés, un enfant contaminé devra subir un examen complet à sa naissance. Il est soumis à un suivi médical durant son enfance jusqu’à l’âge adulte pour prévenir les récidives. En fait, ces formes complexes d’infections sont capables de se réactiver plus tard à l’âge adulte. En conséquence, elles peuvent laisser une cascade de séquelles.
Pour s’assurer de sa santé, il est donc important pour la femme de se faire dépister afin de prendre les précautions en cas de contamination.
Dépistage et traitement de la toxoplasmose
Le dépistage d’un mal est la première étape pour le vaincre. Il permet de connaître son origine et d’enclencher le processus de son traitement.
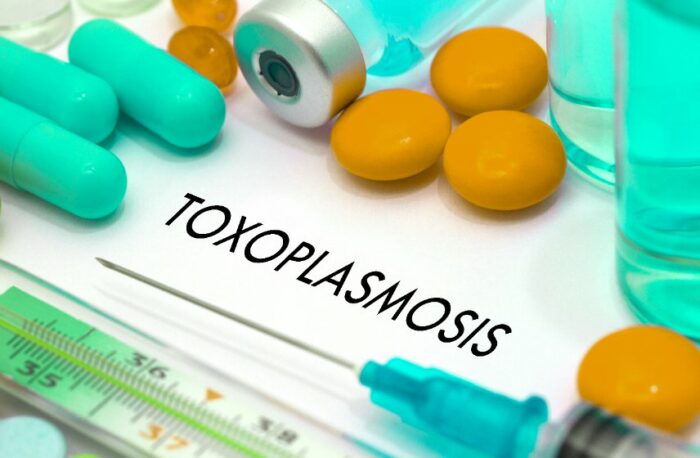
Dépistage
Il est indispensable de savoir si une femme enceinte est porteuse ou immunisée contre le parasite toxoplasma gondii. C’est la raison pour laquelle le dépistage est important. En effet, la sémiologie toxoplasmose (dépistage) doit être faite avant la grossesse.
Dans le cas contraire, elle est obligatoire avant le 3e mois de la grossesse. Ce dépistage doit inclure en même temps les sérologies rubéoles et syphilis.
Il faut savoir que plus de 60 % des femmes n’ont pas contracté le parasite avant la grossesse. Dès lors qu’on est enceinte, il est donc nécessaire de réaliser la sérologie de la toxoplasmose. Elle se fait avec une simple prise de sang.
La sérologie recherche les anticorps synthétisés ou produits par le corps pour lutter contre le toxoplasma gondii. Ce test de dépistage permet de détecter une infection récente ou en cours en fonction des taux des immunoglobulines G et M. Dans ce processus, deux éléments apparaissent dans les résultats :
- IgM: il s’agit des anticorps qui apparaissent d’une manière précoce après la contamination. En général, ils disparaissent au bout de 3 à 6 mois. Il est rare, mais il peut arriver qu’ils persistent à taux faible ;
- IgG: à l’opposé des premiers, ce sont des anticorps qui persistent toute la vie et confèrent une immunité vis-à-vis du parasite.
Par ailleurs, lorsque les IgM se révèlent positives, plusieurs autres examens devront être réalisés pour connaître la date du début de l’infection. Cela permet de savoir si l’infection a eu lieu avant la conception. Au cas où l’infection est antérieure à la grossesse, il n’y a aucun risque pour le bébé.
Voici à cet effet quelques examens qui pourront être effectués :
- La sérologie toxoplasmose sera répétée pour suivre l’évolution des taux d’anticorps IgG et IgM ;
- La mesure de l’indice d’avidité des anticorps IgG. Lorsque l’indice d’avidité des anticorps IgG est élevé, il exclut une toxoplasmose survenue dans les 3 à 4 mois ;
- Une détection par biologie moléculaire dans l’ADN de toxoplasma gondii est aussi possible dans le sang, le liquide céphalo-rachidien ou le liquide amniotique.
Mère immunisée contre le toxoplasme
Quand la femme en état de grossesse est immunisée, son bébé ne court aucun risque. Dans ce cas, il faut :
- Faire une 2eprise de sang un mois plus tard pour confirmer le résultat ;
- Conserver le résultat de cette sérologie durant la grossesse en cours et les autres grossesses à venir.
Dans ce cas de figure, les mesures de prévention de la toxoplasmose ne concernent plus cette femme.
Mère non immunisée contre le toxoplasme
Quand la femme en état de grossesse n’est pas immunisée, elle court de risque et son bébé n’est pas protégé. C’est la raison pour laquelle, elle doit :
- Faire une prise de sang régulière pour la sérologie ;
- Pratiquer cette sérologie si possible dans le même laboratoire toutes les 4 semaines jusqu’à l’accouchement.
La toxoplasmose chez le nourrisson
Après une grossesse marquée par des doutes et des suspicions de la toxoplasmose, il faut effectuer des examens sur l’enfant. Ces examens sérologiques s’étendent au minimum sur 10 mois. Chez le nouveau-né, les tests de sang ou du placenta positifs sont des arguments de certitude.
Chez le nourrisson, la synthèse des anticorps IgG vers 6 mois ou 12 mois est l’argument de diagnostic essentiel. En effet, les anticorps de la mère, en particulier les IgG, disparaissent au bout de 10 mois. En cas d’une évolutivité à moyen et à long termes, l’on peut songer à une particularité de toxoplasmose congénitale.
Dans tous les cas, il faut suivre le traitement adéquat du parasite.
Traitement de la toxoplasmose en état de grossesse
Pour traiter au mieux la toxoplasmose, il convient de mesurer d’abord les risques. Dans ce cas, il faut tenir compte de la catégorie de la personne concernée.
En général, le traitement de la toxoplasmose repose sur la prise des antiparasitaires. Les médicaments peuvent réduire la gravité des effets de l’infection. Cependant, l’ultime et la meilleure approche est la prévention.
Chez les femmes enceintes
En cas de primo-infection pendant la grossesse, la femme doit se rendre le plus tôt possible dans un service hospitalier pour les diagnostics. Si la maladie est confirmée, une prise en charge adaptée est donc préconisée.
Cas de faible risque
Lorsque le risque représenté par la maladie est faible, la femme enceinte est traitée avec un antibiotique dont la spiramycine ou la rovamycine par soins de 10 jours chaque mois jusqu’à l’accouchement. Ces cures diminuent à hauteur de 60 % les risques de transmission.
Attention : ce traitement est insuffisant si le risque d’atteinte fœtale parait élevé ou lorsque cette atteinte a été prouvée par le diagnostic prénatal de la toxoplasmose congénitale.
Chez un fœtus présentant une toxoplasmose congénitale confirmé par une analyse du liquide amniotique
Chez un fœtus présentant une toxoplasmose congénitale confirmé par une analyse du liquide amniotique, il est préconisé une association de deux antibiotiques, notamment la pyriméthamine et la sulfadiazine. Pour éviter les carences, une supplémentation d’acide folique est nécessaire.
En cas extrême, le médecin peut proposer une interruption médicale de la grossesse appelée un avortement thérapeutique.
Chez les personnes immunodéprimées
Chez les personnes immunodéprimées atteintes par la toxoplasmose et présentant un déficit immunitaire considérable, il est mis en place un traitement par association d’antibiotiques. À visée prophylactique, il est prescrit :
- Sulfaméthaxazole + triméthoprime ;
- Ou Sulfaméthaxazole + cotrimoxazole.
Eu égard aux causes et facteurs de la toxoplasmose, se prévenir reste la meilleure option pour éviter de courir de risques parfois fatals. C’est pourquoi il faut suivre de façon rigoureuse certaines bonnes pratiques.
Conseils importants pour éviter la toxoplasmose
Compte tenu des risques évalués, la prévention de la toxoplasmose concerne surtout les personnes dont le système immunitaire est fragilisé et les femmes en état de grossesse. Cette prévention réside de façon particulière dans :
- Une hygiène excellente de mains ;
- Le nettoyage des fruits et légumes souillés de terre ;
- L’évitement des chats.
Pour les femmes en état de grossesse
Avant toute grossesse ou au début de celle-ci, chaque femme doit connaître son statut immunitaire concernant la toxoplasmose. De nombreuses femmes ont déjà contracté le parasite sans avoir subi des symptômes. C’est pourquoi une prise de sang reste indispensable pour vérifier la quantité d’anticorps présents dans l’organisme.
Si la sérologie est négative, chaque femme doit respecter les conseils d’hygiène alimentaires et environnementaux nécessaires. La toxoplasmose se transmet principalement par les aliments infectés par le parasite, toxoplasma gondii.
Les bonnes pratiques à observer
Pour une meilleure prévention, voici quelques conseils :
- Manger de la viande bien cuite (steaks tartares, grillades et fondues bourguignonnes) : une bonne cuisson permet de détruire le parasite qui peut être présent chez l’animal ;
- Éviter la charcuterie crue, fumée ou salée ;
- Ne pas manger des œufs crus ;
- Éviter de consommer de lait non pasteurisé ;
- Laver avec grand soin les fruits et légumes en contact avec le sol ;
- Utiliser les assiettes séparées pour la viande crue et les aliments cuits.
Le parasite de la toxoplasmose peut provenir aussi bien du jardin, de la cuisine que de la litière du chat. C’est pourquoi il ne faut pas négliger les mesures d’hygiène de base :
- Se laver les mains à l’eau et au savon avant chaque repas ;
- Porter les gants pour travailler au jardin ;
- Laver les ustensiles de cuisine de façon correcte et soigneuse à chaque fin de cuisson ;
- Nettoyer les éviers et les plans de travail qui ont été en contact avec de la viande crue ou de la terre ;
- Éviter de porter la main au visage après avoir touché une viande crue.
Mesures particulières concernant le chat
Si le porteur confirmé du parasite de la toxoplasmose est le chat, cela va de soi qu’une grande attention soit faite à son égard. Doit-on s’en débarrasser ? La réponse est négative. En effet, la plupart des chats ont déjà la toxoplasmose et en sont immunisés. Dans ce cas précis, ce chat ne sera contaminant que pendant 10 jours s’il l’attrape.
Vous devez savoir que la contamination se fait par griffure ou par l’intermédiaire de ses excréments. Pour limiter les risques au futur bébé, il faut donc :
- Réduire au maximum le contact avec le chat y compris son environnement ;
- Déterminer le cas échéant le statut sérologique du chat pour savoir s’il est porteur ou non de la toxoplasmose ;
- Faire nettoyer de façon régulière la litière du chat ;
- Laver la caisse du chat à l’eau bouillante ;
- Donner à manger au chat des produits cuits et conserves ;
- Ne pas adopter de chat errant pendant la grossesse ;
- Éviter de boire de l’eau non contrôlée surtout l’eau courante ;
- Ne pas cueillir des fruits sauvages.
ATTENTIONLa toxoplasmose est une maladie non moins dangereuse surtout pour la femme en état de grossesse. Elle peut non seulement engendrer des malformations énormes chez le fœtus, mais aussi provoquer une fausse couche. Il appert donc de respecter les conseils d’hygiène pour la prévenir. En revanche, en cas d’apparition des symptômes de la toxoplasmose, il faut, le plus vite possible, se référer à son médecin.




