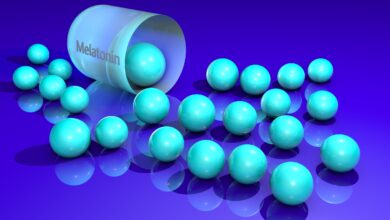Ophtalmologie : Pathologies, Diagnostic, Traitement

L’ophtalmologie est la branche de la médecine spécialisée dans le traitement des affections de l’œil et de ses annexes. Le médecin pratiquant de l’ophtalmologie est appelé ophtalmologue ou ophtalmologiste.
En effet, l’ophtalmologiste traite l’ensemble des maladies de l’œil, des paupières ainsi que des voies lacrymales. De même, il assure la correction des troubles visuels, prescrit des verres correcteurs adaptés à votre maladie (myopie, presbytie, astigmatisme, etc.). Au-delà de cette fonction, il vous diagnostique et soigne les glaucomes, les cataractes et autres affections visuelles.
Cet article vous fournit les informations essentielles sur les pathologies en ophtalmologie, leur diagnostic et leurs traitements.
Pathologies ophtalmologiques
L’œil est un organe sensible et complexe. Il est souvent exposé à de nombreux troubles ou pathologies pouvant affecter chacune de ses parties. En fait, la complexité et la diversité des tissus qui le composent expliquent les nombreuses pathologies qui pourraient l’assaillir.
Pathologies du segment antérieur
Plusieurs affections peuvent troubler et affaiblir les capacités du segment antérieur. Parmi celles-ci, on peut citer :
- Kératocône ;
- Conjonctivite ;
- Kératite ;
- Uvéite antérieure ;
- Cataracte.
Pathologies de la rétine
La rétine et le vitré forment le segment postérieur. Lorsque surviennent certaines pathologies générales, ces deux entités peuvent être touchées. Par exemple, des problèmes mécaniques peuvent survenir sur la structure vitréo-rétinienne. On note principalement le décollement de la rétine.
Mais, d’autres maladies peuvent avoir des répercussions sur la rétine, à savoir :
- Achromatopsie, notamment l’absence totale de vision des couleurs ;
- Albinisme ;
- Amaurose congénitale de Leber ;
- Rétinopathie diabétique ;
- Dégénérescence maculaire liée à l’âge ;
- Trou maculaire ;
- Occlusion de l’artère centrale de la rétine ;
- Maladie de Best, etc.
Pathologies de la paupière
Les paupières font partie des structures qui protègent le globe oculaire. Elles sont également susceptibles de dysfonctionnement représenté par la blépharite. En effet, des troubles de malposition des paupières méritent d’être pris en charge. Il s’agit entre autres de :
- Ptosis ;
- Entropion ;
- Ectropion ;
- Blépharochalasis ;
- Traumatismes palpébraux ;
- Orgelet ;
- Chalazion ;
- Lésion palpébrale.
Glaucomes
Le maintien d’une pression intraoculaire répond à un système précis. Hélas ! La dysrégulation de ce système engendre une pathologie que l’on appelle glaucome. On distingue le glaucome à angle ouvert correspondant au stade chronique. Nous avons aussi le glaucome aigu par fermeture de l’angle.
Principaux troubles de la vision
Troubles de réfraction
Les anomalies de réfraction sont un motif très fréquent de consultation. Elles sont dues à une anomalie du système optique. Ce système est formé par la rétine, le cristallin et la cornée.
Il est bien de savoir que dans un œil normal, le point focal de l’ensemble cornée-cristallin est situé sur la rétine. En effet, en vision de près, le pouvoir d’accommodation du cristallin permet d’avancer le point focal devant la rétine.
Pour quelle raison alors ? Cela, pour conserver une concentration sur la rétine des rayons lumineux qui ne sont plus parallèles, mais divergents. Les anomalies de la réfraction sont représentées par la myopie, l’hypermétropie, l’astigmatisme et la presbytie.
Myopie
Il faut savoir que le point focal est situé devant la rétine. Dans le cas de la myopie, les objets situés à une distance lointaine sont flous pour le malade.
Hypermétropie
Le point focal est situé derrière la rétine. Le patient se voit en effet contraint d’accommoder à tout instant pour avancer le point focal. Cela est dû au fait que les objets proches apparaissent flous en cas du dépassement des capacités d’accommodation.
Astigmatisme
Dans le cas de l’astigmatisme, les rayons lumineux sont focalisés en deux foyers distincts sur la rétine. Cela peut s’expliquer par une irrégularité de la cornée, responsable du défaut de stigmatisme.
Presbytie
Le vieillissement diminue le pouvoir d’accommodation du cristallin. Cet affaiblissement du pouvoir d’accommodation du cristallin rend flous les objets proches, on parle de presbytie. Mais, rassurez-vous, cela n’est point une fatalité.
Heureusement, les verres correcteurs sont là pour corriger ce défaut. Aussi, une intervention chirurgicale en cas de nécessité peut sauver le patient de cette anomalie.
Autres maladies de la vision
Troubles de la vision binoculaire et strabisme
Les troubles de la vision binoculaire sont très nombreux. Ils se traduisent par des difficultés à superposer les objets de l’œil gauche et de l’œil droit. Par conséquent apparaissent des maux de tête et des fatigues visuelles. Celles-ci empêchent souvent les activités visuelles, dont la lecture.
Elles peuvent aller de la mauvaise endurance visuelle à une diplopie, c’est-à-dire une vision double jusqu’au strabisme. Notons que le strabisme est le trouble de la vision binoculaire au stade le plus avancé. À ce niveau, il est impossible de fusionner les images et la vision est désaxée.
Troubles de la vision des couleurs
La gravité des troubles de la vision des couleurs dépend du nombre de types de cônes touchés, à savoir :
- Dysfonctionnement d’un des types de cônes, le patient souffre du daltonisme ;
- Perturbation de deux types de cônes : le monochromatisme au bleu encore appelé achromatopsie incomplète.
- Trouble de trois types de cônes: achromatopsie, absence totale de vision des couleurs.
Ces pathologies font appel à un diagnostic sérieux, car elles peuvent conduire à la cécité.
Diagnostic ophtalmologique
Le diagnostic en ophtalmologie s’effectue à base d’un interrogatoire et des examens physiques.
Examens en ophtalmologie
Le diagnostic en ophtalmologie se base sur plusieurs examens. Comme le dit le SNOF, « il n’y a pas une consultation d’ophtalmologie typique, mais des consultations ». Celles-ci sont différentes les unes des autres en raison de plusieurs facteurs :
- Antécédents familiaux ;
- Antécédents personnels ;
- Traitement médical en cours.
Cela dit, à chaque patient correspond une consultation spécifique ! Celle-ci passe par des examens équivalant à chaque malade. Parmi les nombreux examens disponibles, on note la mesure de l’acuité visuelle.
Mesure de l’acuité visuelle
La mesure de l’acuité visuelle est le plus courant des examens ophtalmologiques. En effet, le patient lit des rangées de lettres majuscules d’imprimerie sur un optotype suspendu au mur. Les lettres sont disposées dans des rangées avec des tailles différentes.
En pratique, le patient se met à une distance de 5 mètres. Par la suite, le spécialiste lui demande quelles sont les plus petites lettres dont il peut distinguer la forme. La notation de l’acuité visuelle est décimale :
- À 10/10, chaque détail est vu sous un angle de 1 minute ;
- A 1/10 sous un angle de 10 minutes.
Il faut retenir que l’acuité visuelle normale finit de se développer à l’âge de 6 ans. Au fil du temps avec l’âge avançant, elle se perd petit à petit. La mesure de l’acuité visuelle s’effectue en pratique avec une étude de la vision de près et de loin, sans correction puis avec elle.
D’autres examens sont possibles en ophtalmologie.
Test du réflexe photomoteur
Le test du réflexe photomoteur permet de définir l’alignement des yeux. Pour ce faire, on envoie la lumière d’une lampe-crayon sur l’arête du nez du patient. La suite consiste à observer la façon dont le faisceau est réfléchi sur l’œil.
En principe, la lumière doit être réfléchie au même niveau sur chaque œil. Par ailleurs, cet examen comprend aussi l’inspection des sourcils, cils et paupières.
Examen des milieux oculaires
Cet examen s’effectue sur les différents milieux oculaires à l’aide du biomicroscope ou « lampe à feinte ». L’objectif est de renseigner le spécialiste sur l’état de la cornée, de la chambre antérieure et du cristallin. Notons qu’il s’agit d’un examen indolore et non invasif.
Examen du tonus oculaire
La mesure du tonus oculaire se fait à l’aide du tonomètre à air. Le tonomètre à aplanation est également utilisé à cet effet.
Examen du fond d’œil
L’ophtalmologue se sert de l’ophtalmoscope pour examiner les structures situées à l’intérieur de l’œil. En effet, cet instrument comporte un système de loupe et une lumière permettant d’éclairer l’arrière de l’œil.
Au début, quelques gouttes sont placées dans l’œil pour dilater les pupilles. Chaque œil est ensuite examiné à la lumière puissante de l’ophtalmoscope. Cet examen permet de détecter les minuscules cicatrices et ulcérations non visibles autrement.
Enfin, le spécialiste passe à l’évaluation de la rétine et du nerf optique. Outre ces examens, il existe des examens complémentaires que peut pratiquer le spécialiste en cas de besoin.
Examens complémentaires en ophtalmologie
L’ophtalmologue peut recourir à d’autres examens complémentaires à savoir : examens analysant la morphologie de l’œil ou examens analysant le fonctionnement de l’œil.
Examens sur la morphologie de l’œil
Les examens liés à la morphologie de l’œil prennent en compte la cornée et le segment antérieur :
- Topographie cornéenne ;
- Tomographie en cohérence optique (OCT) ;
- Échographie oculaire haute fréquence (UBM) ;
- Kératométrie (mesure de la courbure centrale de la cornée) ;
- Pachymétrie cornéenne (mesure de l’épaisseur centrale cornéenne, etc.).
Les examens morphologiques de l’œil portent également sur l’origine du nerf optique (papille) :
- HRT ;
- GDX ;
- Photographie de la papille.
Ils portent également sur le globe oculaire dans son ensemble :
- Échographie ultrasonore conventionnelle et haute fréquence ;
- Biométrie par IOL master.
Examens liés au fonctionnement de l’œil
Les examens liés au fonctionnement de l’œil concernent :
- Bilan orthoptique ;
- Examen de la vision des couleurs ;
- Champ visuel ;
- Réfraction automatique ;
- Aberrométrie ;
- Électrophysiologie : Potentiels évoqués visuels (PEV), électrorétinogramme (ERG), électro-oculogramme (EOG).
Par ailleurs, l’âge peut être un facteur déterminant dans l’examen ophtalmologique. Il faut donc tenir compte de cette spécificité dans les examens.
Examens spécifiques en ophtalmologie

Il peut arriver que certains examens soient demandés hormis la consultation standard. Cela, en fonction de la catégorie à laquelle appartient le patient.
Jeune enfant
Lorsque l’on soupçonne un strabisme chez un jeune enfant :
- Il faut rechercher une amblyopie ;
- Faire l’examen sous cycloplégie médicamenteuse ;
- Examiner la vision binoculaire et réaliser une stéréoscopie.
On peut également faire l’examen du fond d’œil pour rechercher une cause organique.
Jeune en âge scolaire
Chez les jeunes en âge scolaire, il est préconisé de la recherche d’une amétropie. L’examen de la vision binoculaire, de la vision des couleurs, de la stéréoscopie, du fond d’œil peut être pratiqué.
Adulte autour de 40 ans
Chez les adultes d’environ 40 ans, la recherche d’une amétropie de loin et de près est nécessaire. Aussi, le spécialiste fera une prise du tonus oculaire systématique et un examen du fond d’œil.
Adulte à partir de 60 ans
Chez les adultes ayant 60 ans et plus, il est recommandé de faire la recherche d’une modification de la transparence des milieux d’une hypertonie oculaire. Recherchez aussi les anomalies du vieillissement au niveau de la zone maculaire.
Ces examens peuvent révéler des pathologies ophtalmologiques qu’il est nécessaire de traiter convenablement.
Traitement en ophtalmologie
En ophtalmologie, plusieurs traitements sont disponibles : traitements médicamenteux, traitements au laser ou traitement chirurgical.
Traitements médicamenteux : les mydriatiques
Certains traitements médicamenteux en ophtalmologie se basent sur les collyres mydriatiques et les mydriatiques cycloplégiques.
Collyres mydriatiques
Les collyres mydriatiques sont des substances parasympatholytiques (tropicamide) ou sympathomimétiques (néosynéphrine). Elles permettent respectivement d’obtenir la dilatation de la pupille. Cela s’explique par le fait qu’elles bloquent le sphincter ou stimulent le dilatateur de l’iris.
Les collyres mydriatiques sont en particulier utilisés pour l’examen ou la chirurgie de la chambre postérieure et du segment postérieur. Leurs effets sont très vite remarqués. En effet, ces substances commencent à agir dans l’intervalle de 20 à 30 minutes après application.
Notons par ailleurs que leur durée d’action est de quelques heures. Toutefois, les mydriatiques peuvent susciter un blocage pupillaire. Par conséquent, ils peuvent entrainer une crise de glaucome aigu par fermeture de l’angle.
Les mydriatiques sont contre-indiqués de façon transitoire chez les personnes à risque de glaucome aigu par fermeture de l’angle. Et ce, jusqu’à réalisation de l’iridotomie bilatérale.
Collyres mydriatiques cycloplégiques
Il s’agit des substances parasympathicolytiques atropiniques. Les collyres mydriatiques cycloplégiques permettent d’obtenir la paralysie transitoire des muscles, outre la mydriase. Elles ont heureusement une action prolongée sur plusieurs jours.
Les mydriatiques cycloplégiques sont indiqués en cas d’inflammation intraoculaire. Ils ont une action antalgique. Ils diminuent le risque de formation de synéchies irido cristalliniennes. Soulignons que ces substances peuvent favoriser la survenue d’un blocage pupillaire comme tout mydriatique.
Traitements médicamenteux : collyres myotiques, hypotonisants oculaires
En dehors des collyres mydriatiques, nous avons également les collyres myotiques et hypotonisants oculaires.
Collyres myotiques
Les collyres myotiques sont des substances cholinergiques type pilocarpine servant à resserrer la pupille. Ils sont utilisés pour lever un blocage pupillaire en cas de traitement de la crise de glaucome aigu par fermeture de l’angle.
Notons qu’ils viennent en complément du traitement hypotonisant. En effet, les myotiques sont instillés dans les deux yeux jusqu’à réalisation de l’iridotomie bilatérale. Cela permet d’éviter un nouveau blocage pupillaire.
Collyres hypotonisants oculaires
Les collyres hypotonisants oculaires sont utilisés pour faire diminuer la pression intraoculaire. En effet, ils baissent la sécrétion d’humeur aqueuse en augmentant son excrétion. Ils sont administrés par voie locale en collyre et plus ou moins par voie générale en cas d’hypertension sévère.
Il faut relever que les bêtabloquants constituent la principale classe de collyres hypotonisants. Il s’agit des collyres diffusant dans la circulation générale à partir de la muqueuse. Il est important de savoir qu’ils sont absolument contre-indiqués dans les cas suivants :
- Asthme ;
- Troubles respiratoires ;
- Bloc auriculo-ventriculaire de haut degré ;
- Bradycardie.
La liste des médicaments en ophtalmologie est aussi longue que celle des pathologies liées à la vue. Cependant, il est bien de connaitre les plus importants d’entre eux.
Autres médicaments en ophtalmologie
Nous distinguons d’autres médicaments pour le traitement en ophtalmologie à savoir : les collyres anti-inflammatoires, anti-infectieux, collyres lubrifiants et cicatrisants.
Les collyres anti-inflammatoires
Ils sont soit stéroïdiens ou soit non stéroïdiens, les collyres anti-inflammatoires. Ils sont utilisés sous forme de collyres pour réduire les inflammations du segment antérieur.
Anti-inflammatoires non stéroïdiens
Les collyres anti-inflammatoires non stéroïdiens sont indiqués en cas d’inflammation de surface et en postopératoire. Notons que les anti-inflammatoires non stéroïdiens sont peu efficaces lorsqu’il s’agit d’une inflammation intraoculaire. Il est capital de savoir qu’ils sont contre-indiqués en cas d’allergie.
Anti-inflammatoires stéroïdiens
Les collyres anti-inflammatoires stéroïdiens sont indiqués en cas d’inflammation intraoculaire et en postopératoire. Toutefois, en cas d’atteinte épithéliale, ils sont contre-indiqués. Les anti-inflammatoires stéroïdiens peuvent provoquer des effets indésirables :
- Systémique: on relève peu de risque d’effets indésirables généraux liés aux collyres. C’est donc en raison des faibles doses utilisées ;
- Locaux: risque d’effets indésirables importants et majorés par une utilisation au long cours.
Collyres anti-infectieux
On note parmi les collyres anti-infectieux :
- Les antiseptiques: ils sont suffisants pour le traitement d’un bon nombre d’infections oculaires superficielles, types conjonctivites bénins. Cette efficacité est encore plus manifeste en association avec un collyre AINS ;
- Antibiotiques: ils sont indiqués en cas d’infection de surface plus profonde d’allure bactérienne ou d’infection superficielle survenue en terrain fragile ;
- Antiviraux: ils sont indiqués en cas d’atteinte d’allure herpétique par voie locale ou générale. Soulignons que les anti-inflammatoires stéroïdiens sont contre-indiqués dans ce cas.
Collyres lubrifiants et cicatrisants
Les collyres lubrifiants et cicatrisants sont indiqués en cas d’altération de la surface oculaire ou du film lacrymal. Ils permettent de protéger et de nourrir la surface oculaire. Nous avons :
- Collyre lubrifiant : lames artificielles ;
- Collyre cicatrisant: pommade vitamine A.
Traitement au laser
On distingue 2 types de laser : laser Argon et laser YAG. En effet, la transparence des milieux oculaires permet de focaliser les rayons laser sur les différentes structures intraoculaires.
Laser Argon
Le laser Argon libère une énergie sous forme de chaleur. Celle-ci permet de brûler le tissu cible : photocoagulation. En effet, on distingue deux types de photocoagulations :
- Photocoagulation rétinienne périphérique ;
- Photocoagulation des déchirures rétiniennes périphériques.
Outre les photocoagulations, d’autres applications sont possibles avec le laser Argon. Il s’agit de :
- Trabeculoplasties ;
- Cautérisations d’anomalies vasculaires.
Laser YAG
Contrairement au laser Argon, l’énergie libérée par le laser YAG est sous forme d’onde de choc. Elle sert à sectionner le tissu cible. On parle de la photodisruption. Les principales indications à retenir sont :
- Iridotomie périphérique: consiste à perforer l’iris au niveau de la racine. Elle permet de prévenir le risque de glaucome aigu par fermeture de l’angle ;
- Capsulotomie: indiquée en cas d’opacification capsulaire secondaire.
Par ailleurs, certaines pathologies peuvent nécessiter des traitements radicaux du fait de leur gravité.
Traitement chirurgical en ophtalmologie
Le traitement chirurgical est possible en ophtalmologie et s’effectue selon le type de pathologie et sa localisation.
La greffe de cornée
La greffe de cornée est indiquée de façon particulière en cas d’opacité cornéenne centrale. Soulignons qu’il ne s’agit pas de la transplantation, mais plutôt d’une greffe parce que la cornée est avasculaire. Cette greffe s’effectue à partir de cornées prélevées sur des cadavres dans les heures suivant le décès.
Rassurez-vous, le prélèvement se fait selon un protocole bien encadré. De plus, le risque de rejet est très limité en raison du caractère avasculaire du tissu greffé.
Chirurgie de cataracte
La chirurgie de cataracte est le traitement recommandé dans les cas d’opacification cristallinienne. Notons que celle-ci est à l’origine d’un trouble de transparence perturbant la vision.
Outre ces deux traitements chirurgicaux, l’ophtalmologue peut aussi pratiquer la chirurgie de :
- Glaucome ;
- Vitréo-rétinienne ou encore les injections intra vitréennes.
Comme tout autre organe, les yeux occupent une place irremplaçable. Ils doivent être traités avec soin, la diversité de ses structures impliquant également la diversité des pathologies dont il peut faire l’objet. Ainsi, en cas d’apparition d’un symptôme, veuillez surtout vous référer à l’ophtalmologue.