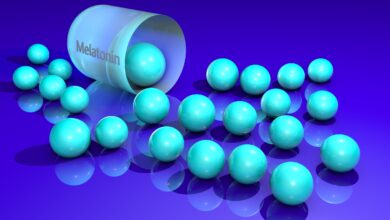La médecine générale s’est longtemps appuyée sur des fondements empiriques qui constituent un ensemble intrinsèquement subjectif. De nombreuses études ont tenté de fournir les concepts théoriques nécessaires pour décrire et expliquer comment cela fonctionne. La découverte des principes fondamentaux qui régissent l’organisation de la médecine générale conduit à une définition plus précise de la notion. Il s’agit en réalité d’une étape importante dans l’élaboration d’un modèle conceptuel et l’émergence d’un champ scientifique. Pour fonctionner, la médecine générale se base sur des démarches et principes qu’il convient d’élucider ici.
Médecine générale : Définition
La médecine générale est chargée de fournir des soins médicaux généraux à l’échelle de la communauté. Elle ne se limite pas à un certain groupe d’âge, système d’organes ou sexe. Le médecin généraliste, parfois appelé omnipraticien, est donc l’expert de santé chargé de suivre, prévenir, traiter et soigner les malades de sa communauté.
En coordonnant les soins du patient dans la communauté, la médecine générale assure une évaluation complète du malade. C’est avant tout un médecin de proximité qui joue un rôle crucial dans la prise en charge des patients âgés et en situation de précarité. De plus en plus de médecins généralistes travaillent dans des cabinets médicaux, ce qui permet d’élargir leurs domaines d’expertise et de faciliter les consultations.
Médecine générale : Démarches médicales
En médecine générale, il existe deux démarches médicales : la démarche diagnostique et la démarche décisionnelle.
Démarche diagnostique
Une grande illusion collective fait croire qu’un médecin peut toujours confirmer un diagnostic après vingt minutes de consultation. Il lui faut généralement plus de temps pour observer et identifier surtout l’état clinique avec précision. Cela permet de prendre les décisions appropriées et de faire une meilleure évaluation des risques de la situation.
Situation clinique
Les défis quotidiens auxquels le médecin généraliste est confronté s’avèrent légion.
- Le traitement des problèmes de santé: il s’agit des pathologies qui sont encore aux premiers stades de développement et qui correspondent rarement à une maladie à part entière.
- Le manque d’outils de diagnostic et de plateau technique.
- La prise de décisions dans un court laps de temps (18 minutes en moyenne)…
Après la consultation, le médecin généraliste est souvent laissé sans certitude sur la cause de la malade. En effet, 70 % des consultations concernent des circonstances qui ne sont pas révélatrices d’une maladie : il s’agit de l’incertitude diagnostique. Dans ce cas, deux sortes de difficultés s’invitent. Dans un premier temps, il pense à réduire le diagnostic à un point de contact face à l’incertitude. Dans un second temps, il se demande si poser un diagnostic sans données à l’appui est l’idéale.
Le médecin doit identifier avec précision chaque situation clinique qu’il prend en charge. Ensuite, il devra évaluer le risque associé à chaque situation clinique afin d’éviter ces deux contradictions et de prendre les décisions appropriées.
Identifier la situation clinique
Pour nommer la situation clinique, les médecins généralistes utilisent le dictionnaire des résultats de consultations (DRC). Ce dernier regroupe les différents scénarios cliniques qu’un médecin généraliste rencontre en moyenne au moins une fois par an.
Le résultat de l’analyse du clinicien est défini par le niveau de certitude clinique atteint par le praticien à la fin de la consultation. Le dictionnaire des résultats de la consultation est fondé sur trois facteurs :
- le résultat de la consultation,
- la position diagnostique,
- le suivi du code.
Dans la position diagnostique, le médecin est confronté à quatre scénarios cliniques différents. Il s’agit de :
- symptôme (A),
- syndrome (B),
- tableau de la maladie (C),
- et maladie confirmée (D).
Cette catégorisation est dénommée « position diagnostique ». Dès la confirmation d’une maladie, la situation clinique est résolue et le médecin pourra donner le diagnostic avec précision.
Cependant, face à un symptôme ou un syndrome, la situation clinique est ouverte à une variété de diagnostics ou d’évolutions. La position diagnostique permet au médecin de maintenir la vigilance mentale et de surveiller le développement d’une éventuelle maladie. Cette idée d’ouverture aux changements potentiels est essentielle pour valider ou invalider les hypothèses du médecin.
Par ailleurs, le « Code Suivi » permet au médecin de préciser si l’état du patient est nouveau ou suffisamment persistant pour être considéré comme chronique. Il permet d’en savoir plus sur le déroulement de l’épisode médical. Il existe deux codes correspondants. Le premier est matérialisé par la lettre N qui représente un nouveau cas, souvent connu comme la première observation d’un médecin. Le second est représenté par la lettre P qui représente un cas persistant.
Toutefois, il existe un code R qui s’utilise lorsque la circonstance a changé ou a été clarifiée et appelle à sélectionner un RC plus approprié.
Risques inhérents à chaque situation clinique
Après avoir identifié l’issue de la consultation, le médecin doit considérer les diagnostics étiologiques graves posés par la situation clinique (RC). Le médecin de premier recours doit considérer la possibilité d’une étiologie grave dans sa démarche diagnostique, souvent lointaine, mais non nulle.
Tout praticien est exposé à un risque grave d’une étiologie. Le risque est que le praticien évite d’évoquer devant le RC sélectionné toute maladie grave susceptible de modifier l’état du patient. Il est essentiel pour le processus de diagnostic de garder les risques à l’esprit.
La même symptomatologie peut indiquer aussi bien une pathologie bénigne qu’une pathologie grave. L’enjeu pour le praticien est de considérer les risques potentiellement graves, et ce en évitant de démarrer une enquête qui serait stressante et coûteuse. Il doit veiller à ce que cela ne produise pas des effets néfastes qui sont susceptibles de conduire à des résultats défavorables.
L’évaluation des risques est essentielle au processus de diagnostic. Pour évaluer le risque, il faut tenir compte de la gravité, de l’urgence, de la curabilité et de la vulnérabilité du patient de chaque danger. Ces 4 facteurs vous permettent de déterminer la gravité de chaque risque afin de réussir le Diagnostic Étiologique Critique (DEC).
Démarches décisionnelles
Il est déconseillé de prendre des décisions à la lumière des résultats de la consultation et des risques graves encourus. En effet, outre les facteurs liés au patient, au médecin et à son environnement, l’efficacité des décisions médicales dépend également d’autres facteurs.
Les caractéristiques du patient comprennent ses antécédents médicaux, y compris les pathologies associées et les facteurs de risque généraux. De plus, ses déterminants socioculturels, tels que le niveau d’éducation, la communauté de culture, le niveau de revenu, sont pris en compte. Son parcours et sa personnalité (rapport à la maladie, situation familiale, etc.) constituent également des facteurs non négligeables.
Quant au médecin, ses caractéristiques comprennent sa formation initiale et continue, son expérience et ses domaines d’expertise. De même, sa méthode et ses conditions d’exercice, sa résistance à la pression de l’industrie pharmaceutique sont autant de critères qui le définissent. Pour mieux l’apprécier, sa personnalité, son aversion au risque et sa norme culturelle ne doivent pas être négligées.
Suite à la désignation de la condition clinique considérée, le praticien évalue les diagnostics potentiellement graves à éliminer rapidement. Il prend en considération les facteurs environnementaux (patient, médecin, environnement) lors de la négociation des décisions.
La négociation dans les décisions
Les décisions proposées par le professionnel de la santé feront l’objet d’une négociation. Elles sont basées sur les données biomédicales, les caractéristiques du patient, du médecin et des éléments structurels. Dans un premier temps, le médecin détermine l’option souhaitable en fonction des particularités de la situation clinique (RC).
Des procédures et des recommandations de bonnes pratiques sont définies et fréquemment codifiées dans les postes de maladie confirmée (D). La conduite à tenir est simple, mais la latitude de manœuvre du médecin est assez restreinte.
En cas de symptôme (A), comme une douleur épigastrique, la situation est plus compliquée. Les risques sont non seulement relatifs à l’estomac, mais aussi au pancréas et au cœur. La marge de manœuvre du médecin est plus critique dans cette situation.
La persistance (P) d’un problème clinique réveille le praticien. Cette alarme l’oblige à choisir une ligne de conduite plus approfondie et moins négociable. Par exemple, des investigations seront nécessaires si une ÉPIGASTRALGIE persiste.
Le seuil de négociation varie selon l’âge, le sexe, les comorbidités et les allergies du patient. Le médecin doit réévaluer les risques (DEC) en tenant compte des facteurs précités en fonction de leur niveau de critique. En fonction des caractéristiques du patient, du médecin et des facteurs structurels, le médecin évalue concrètement la solution à mettre en œuvre.
De ce fait, lorsque le patient exprime sa volonté, le médecin l’informe de la sienne. La négociation a lieu entre le souhait du médecin et celui du patient.
Espace de liberté pour décider
Le médecin a une marge de négociation lorsqu’il prend des décisions. On parle de « l’espace de liberté ». Ceci est directement lié aux caractéristiques de la situation clinique du patient, du médecin et des éléments structurels. Chaque qualité est plus ou moins importante selon les circonstances. Par exemple, le degré du scénario clinique ou les caractéristiques du patient peuvent restreindre considérablement sa liberté de mouvement.
Médecine générale : Les principes

De nombreux modèles théoriques ont été proposés afin de définir la médecine générale. Une conception préliminaire parlait d’un système composé d’une pièce de chaque spécialité, qui, une fois assemblée, formerait un ensemble cohérent.
Dans cette optique, la médecine générale serait une discipline disparate composée de bribes de connaissances sur tout. Cette idée est centrée sur la maladie et ignore une réalité plus nuancée.
De même, et dans l’intérêt de l’unanimité médicale, une définition différente a été proposée. La pratique de la médecine en général équivaudrait à utiliser les mêmes connaissances médicales à l’extérieur de l’hôpital. Elle ne serait qu’une discipline d’exercice selon cette théorie. Alors que son contenu serait similaire à celui de la médecine interne, par exemple, ses exigences d’application seraient uniques. Ce point de vue, centré sur la médecine, ne peut couvrir l’intégralité de la pratique. Ces deux modèles sont inadéquats parce qu’ils simplifient fortement l’identité de la médecine générale.
Les principes essentiels
Le fondement de l’approche théorique de la médecine générale repose sur dix principes fondamentaux. Leur cohabitation permet de définir une discipline clinique.
1. Approche centrée sur le patient
Le point de départ de l’approche clinique est le patient (ses besoins, ses désirs et sa personnalité). Il est aussi important de s’occuper du vécu de la maladie que du mal lui-même, car l’anamnèse centrée sur le patient optimise le résultat final. Quatre conséquences en découlent :
- la décision résulte d’une négociation avec le patient,
- la prise en compte des aspects personnels demande un travail relationnel et donc une formation adéquate,
- la relation médecin-malade qui résulte de cette approche, inclut le médecin dans le processus thérapeutique,
- dans les études épidémiologiques, la primauté du patient nécessite l’utilisation de classifications à plusieurs entrées comme la Classification Internationale des Soins Primaires (CISP).
Il faut donc retenir que le dénominateur commun est la personne (le malade) avec ses croyances, ses peurs, ses attentes et ses affections.
2. Prise en compte de l’environnement du patient
La relation du patient avec son environnement est permanente. Régulièrement, la famille, ses contextes sociaux et professionnels ont tous un impact sur les problèmes psychologiques. De même, son bagage culturel, ses coutumes et ses circonstances de vie participent à cette relation. Le patient ne peut pas être tenu hors contexte et différents facteurs d’influence sont pris en compte lors de sa prise en charge.
Chaque patient a une histoire personnelle et familiale unique, et la maladie prend tout son sens dans ce contexte. Les décisions médicales tiennent compte des effets des événements de la vie qui surviennent au cours de la vie du patient.
Cette approche globale clarifie la signification des symptômes en se concentrant sur le patient et en étant ouverte sur son environnement. La proximité de l’environnement sur le terrain facilite la connaissance de l’environnement. Cependant, elle fait également appel à des compétences humaines développées.
3. Besoins et demande des patients
La médecine générale est la source d’aide la plus courante et la plus facile d’accès pour les problèmes de santé. Elle crée un domaine d’intervention adapté aux demandes et aux besoins des patients. Ce point de vue couvre un large éventail de domaines et propose des soins multiformes. Elle se traduit par le développement de compétences adéquates et évolutives. Ainsi, chaque pratiquant assure tout ou une partie des soins en prenant l’engagement dans une géométrie variée.
De plus, le rôle de la médecine générale, qui se situe à l’intersection des institutions médico-sociales est crucial. Maintenir l’équilibre entre des demandes a priori opposées implique la gestion simultanée des intérêts individuels et des problèmes collectifs.
4. Réponse des motifs de recours aux soins
D’après l’étude du CREDES, toutes les questions liées à la consultation sont prises en charge prioritairement par la médecine générale. Cependant, les questions ophtalmologiques, obstétricales et dermatologiques n’en font pas partie. Une part importante porte notamment sur les maladies endocriniennes et métaboliques (91 %).
Les troubles digestifs, les atteintes des systèmes cardio-vasculaire ou respiratoire, les lésions traumatiques ou ostéoarticulaires représentent plus de 80 %. Les troubles mentaux et les troubles de sommeil ont une part de 65 %.
Ainsi, la majorité des problèmes de santé de la population, qu’ils soient biologiques ou psychiques, sont pris en charge et/ou suivis par la médecine générale.
5. Démarche diagnostique par la faible prévalence des maladies graves
La prévalence est le rapport entre le nombre total de cas d’une maladie et la population à risque de contracter cette maladie. Faute de sélection, cette prévalence est plus faible en médecine générale qu’à l’hôpital pour des affections pouvant être graves ou mortelles.
À des fins de diagnostic, la valeur prédictive d’un signe clinique ou d’un test dépend de la prévalence de la maladie dans la communauté en question. La valeur prédictive positive diminue à mesure que sa prévalence est faible. Ainsi, un même signe n’a pas la même valeur prédictive à l’hôpital et en ambulatoire. Ce qui explique les variations dans les processus décisionnels.
6. Intervention au stade précoce des maladies
Le patient consulte fréquemment dès l’apparition des symptômes. Cependant, il est difficile de poser un diagnostic précis et définitif à ce stade précoce. Les signes cliniques sont plus évocateurs au premier stade. Toutefois, il n’en est pas de même pour les premiers signes, souvent indistincts.
Après avoir exclu une évolution négative à court terme, il est possible d’attendre le développement potentiel de l’attachement. Des taux de prévalence insuffisants et des stades précoces de la maladie empêchent l’élaboration d’un diagnostic approfondi.
Le diagnostic est le plus souvent posé au niveau des symptômes cardinaux ou du groupe de symptômes. Parfois, il peut se retrouver au niveau du tableau de la maladie, mais rarement au niveau du diagnostic complet.
7. Traitement simultané de plusieurs pathologies et affections
Le patient demande fréquemment des conseils pour de nombreux problèmes. Il a généralement deux points de recours et ce nombre augmente avec l’âge. Les polypathologies sont fréquentes et sont particulièrement problématiques pour les personnes âgées.
Typiquement, un acte médical regroupera toutes ces demandes à la fois en médecine. La réalisation simultanée de différentes demandes nécessite une approche hiérarchisée de résolution de problèmes qui tient compte à la fois des priorités du patient et du médecin.
8. Suivi à long terme
En général, la médecine développe une stratégie à long terme et immédiate. Elle donne au patient la chance d’obtenir des soins continus au fil du temps et la chance d’être suivi de la conception à la mort. En effet, elle assure la continuité des soins en accompagnant les patients tout au long de leur vie.
Le dossier médical fournit des preuves claires et facilite ce suivi. C’est la mémoire objective des consultations, mais ce n’est qu’un morceau de l’histoire partagée entre le patient et le médecin. La charge émotive qui augmente fréquemment au fil des rencontres n’est pas aussi développée.
9. Aptitudes à la coordination des soins
L’existence d’un dispositif de coordination est nécessaire pour la coordination des différentes procédures médicales du patient. La médecine générale assure ce rôle crucial, même si les prérequis structurels ne sont pas toujours réunis.
Le rôle de coordination peut parfois être compliqué par un accès direct à des experts et à d’autres professionnels de la santé. Le développement de réseaux coordonnés et de systèmes de prestation de services permet d’envisager un travail d’équipe centré sur le patient, améliorant la qualité des soins.
10. Pratique efficiente
Le traitement des problèmes actuels nécessite des réponses simples et évite souvent une évolution négative qui conduirait à des tâches plus difficiles et compliquées. En effet, la surenchère des explorations est limitée par un léger plateau technique, ce qui réduit également les coûts. Ainsi, la proximité, la continuité et la coordination de la prise en charge du patient optimisent la réponse médicale.
Le médecin limite généralement les dépenses aux besoins réels et suggère au patient une approche sensée de l’utilisation des services médicaux. C’est une pratique efficace au sens économique qui renoue avec les notions de coût/efficacité et de coût/utilité. Rapportée au nombre de patients soignés, la faible contribution de la médecine générale aux dépenses de santé témoigne de cette réalité.
Médecine générale : Modèle global
La médecine générale est théoriquement construite sur un modèle différent de la médecine de spécialité. Elle s’appuie sur des connaissances biomédicales de base partagées. De plus, elle reproduit un modèle complet qui est centré sur le patient, mais tourné vers l’extérieur. Elle considère la maladie comme le résultat d’une variété de facteurs organiques, sociaux et environnementaux.
Cette théorie de la santé qui est considérée comme un phénomène multidimensionnel est liée à l’approche bio-psychosociale d’Engel. Elle a besoin d’un système d’enseignement spécialisé qui puise à la fois dans les sciences biologiques et humaines. Elle doit également viser à développer des compétences scientifiques et interpersonnelles.
Par ailleurs, la médecine générale doit s’appuyer sur des recherches pratiques qui permettent d’amplifier et de vérifier son contenu. Ce modèle global intègre les fonctions spécifiques à la médecine générale.
Il s’agit des premiers secours, de la responsabilité globale, de la continuité et du suivi, de la coordination des soins et des rôles de santé publique. Le modèle se distingue par des stratégies thérapeutiques et des approches diagnostiques spécifiques.
En outre, il détermine les devoirs professionnels qui découlent des fonctions et permettent leur mise en œuvre sur le terrain. Ce modèle global permet de décrire une spécialité médicale qui se situe au carrefour de l’individuel et du collectif.
Le modèle global issu de ces principes s’organise en un ensemble conceptuel. De plus, l’adoption par la communauté généraliste renforce la discipline dans ses aspects de soin, d’enseignement et de recherche.