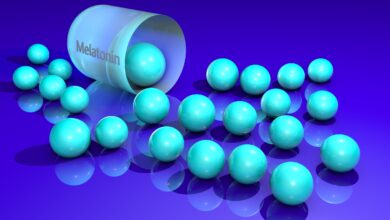La biologie est une science à part entière à la fois vaste et polyvalente. Elle étudie les organismes vivants dans leur environnement physiologique et cellulaire. En médecine moderne, elle fournit des biomarqueurs utiles dans l’identification d’anomalies susceptibles d’aider au diagnostic de plusieurs maladies. Il s’agit entre autres du diabète, des maladies auto-immunes et des anémies. Voici les principaux marqueurs d’anomalies utilisés en biologie.
Classification des biomarqueurs d’anomalies
Les marqueurs utilisés en biologie pour le diagnostic d’anomalies sont nombreux. On les répertorie en trois principaux groupes. Ainsi, on distingue :
- Les biomarqueurs d’anomalies à usage très courant ;
- Les biomarqueurs d’anomalies à usage moins courant ;
- Les biomarqueurs d’anomalies à usage rare.
Il existe aussi d’autres marqueurs biologiques qui n’appartiennent pas à ces différentes catégories. Ils sont rarement utilisés et parfois, peu documentés.
Biomarqueurs d’anomalies à usage très courant
Les biomarqueurs d’anomalies à usage très courant regroupent des marqueurs utilisés fréquemment tels que :
- La glycémie ;
- L’hémoglobinémie ;
- Le taux d’hématocrite ;
- La calcémie ;
- Le fer sérique (sidérémie) ;
- La ferritinémie ;
- La kaliémie.
Plus d’informations sont disponibles sur ces biomarqueurs d’anomalies dans les sections suivantes.
Glycémie
La glycémie est la mesure du taux de glucose présent dans le sang. En général, on l’exprime soit en millimoles de glucose par litre de sang ou en milligramme de glucose par décilitre de sang. Elle figure parmi les marqueurs biologiques les plus utilisés et ses variations permettent de diagnostiquer plusieurs maladies.
L’hyperglycémie constitue le principal biomarqueur du diabète. C’est une maladie chronique qui entraîne d’importants décès dans le monde. Outre le diabète, ce marqueur contribue également à l’identification d’anomalies hépatiques et permet le diagnostic de certaines maladies infectieuses.
L’hypoglycémie quant à elle permet essentiellement de diagnostiquer l’hépatite et les problèmes rénaux. Cependant, on peut parfois l’utiliser pour rechercher des anomalies du pancréas pouvant provoquer une surproduction d’insuline. Dans certains cas plus rares, elle constitue le marqueur de carences en cortisone ou d’autres hormones intervenant dans le métabolisme glucidique.
Hémoglobinémie
L’hémoglobinémie correspond à la concentration d’hémoglobine dans le plasma sanguin. On la mesure en gramme par décilitre de sang et ses variations présentent plusieurs intérêts diagnostiques. La baisse de la concentration d’hémoglobine constitue un marqueur majeur de plusieurs anémies. Il s’agit entre autres des anémies macrocytaires, des anémies microcytaires et des anémies normocytaires.
La hausse du taux d’hémoglobine est un marqueur de polyglobulies. On la retrouve aussi bien en cas de polyglobulies primaires que de polyglobulies secondaires.
Taux d’hématocrite
Le taux d’hématocrite est un marqueur biologique utilisé généralement en complément à l’hémoglobinémie. Habituellement, il est mesuré au cours d’une analyse sanguine et il s’exprime en pourcentage. Ses variations permettent d’apprécier la concentration de globules rouges (hématies) dans le sang.
Un taux d’hématocrite bas veut généralement signifier que la quantité de globules rouges présents dans le sang est faible. Il permet de poser le diagnostic de plusieurs anémies. Il y a entre autres les anémies hémorragiques, les anémies ferriprives, les anémies aplasiques et les anémies hémolytiques.
À l’opposé d’un taux bas d’hématocrites, un taux élevé d’hématocrite traduit un excès de globules rouges dans le sang. Dans cette situation, le marqueur constitue une aide au diagnostic de plusieurs maladies. Il y a par exemple la maladie de Vaquez, les cardiopathies congénitales et certaines maladies pulmonaires.
Calcémie
La calcémie correspond au taux de calcium présent dans le sérum sanguin. Elle est exprimée en milligramme par litre de sang et ses variations constituent des marqueurs biologiques de diverses affections.
L’hypercalcémie permet principalement de poser le diagnostic de l’hyperparathyroïdie primaire dont elle représente la cause majeure. On estime, en effet, que sur 100 patients souffrant d’hyperparathyroïdie, environ 90 ont une hypercalcémie. Excepté le diagnostic de l’hyperparathyroïdie primaire, l’hypercalcémie est aussi un marqueur de maladies cancéreuses. Il permet de diagnostiquer les cancers métastatiques du poumon, des reins, du sein, des testicules et de la thyroïde.
L’hypocalcémie est un marqueur biologique de l’hypoparathyroïdie. Elle constitue également une aide au diagnostic de certaines maladies. Il s’agit notamment des maladies entraînant une carence en vitamine D et les maladies génétiques comme l’hypocalcémie autosomique dominante.
Fer sérique
Le fer sérique (sidérémie) correspond au taux de fer présent dans le sang. On le mesure généralement en microgrammes par décilitre et il permet de mettre en évidence plusieurs anomalies. Un taux de fer sérique bas traduit souvent une carence ferriprive. Il constitue une aide au diagnostic de la malnutrition, de problèmes d’absorption, de gastrectomies et d’hémorragies.
Parfois, il peut également figurer parmi les marqueurs biologiques utilisés pour le diagnostic de syndromes inflammatoires.
Un taux de fer sérique élevé traduit principalement une surcharge ferriprive. Il représente le marqueur majeur d’une hémochromatose primitive. Cependant, on peut également l’utiliser comme une aide au diagnostic d’une hémochromatose secondaire et d’autres maladies hépatiques. Par exemple, les cirrhoses hépatiques et les cytolyses hépatiques. Quelquefois, le taux de fer sérique élevé permet de rechercher certaines anémies spécifiques. Par exemple, les anémies sidéroblastiques, les anémies dites réfractaires et les anémies de Biermer.
Ferritinémie
La ferritinémie permet de mesurer la quantité de ferritine (protéine de stockage du fer) présente dans le plasma sanguin. On l’estime généralement en microgrammes par litre et ses variations constituent une aide à la recherche de plusieurs anomalies.
Une hyperferritinémie c’est-à-dire un taux de ferritine élevé peut constituer un marqueur pour les maladies suivantes :
- Une hémochromatose primitive ou secondaire qui traduit un excès de fer dans les tissus de l’organisme ;
- Les cancers et spécifiquement les cancers du foie, du poumon, du pancréas, des seins et des reins ;
- Les hémopathies et principalement les leucémies de forme aiguës ;
- Une anémie sidéroblastique ou hémolytique ;
- Une hépatite virale ou une hépatite aiguë ;
- Une thalassémie bêta majeure.
Parfois, les hyperferritinémies peuvent aussi représenter le signe d’un syndrome infectieux ou d’un syndrome inflammatoire comme la polyarthrite.
Par opposition à une hyperferritinémie, l’hypoferritinémie traduit généralement une carence en ferritine. Elle représente un des marqueurs biologiques d’une carence ferriprive et peut constituer le signe d’une grossesse ou d’une hémolyse.
Kaliémie
La kaliémie correspond au taux de potassium présent dans le sang ou dans les urines. On l’estime par litre de sang ou d’urine et ses variations indiquent plusieurs anomalies. Une hypokaliémie, c’est-à-dire un taux bas de potassiums dans l’organisme constitue un marqueur majeur de l’hyperinsulinémie et l’alcalose métabolique. Elle intervient dans le diagnostic de plusieurs maladies ou conditions physiologiques. Il s’agit entre autres de l’anorexie, de l’alcoolisme, de l’hypertension artérielle, de la néphropathie interstitielle et de l’hypercorticisme.
L’hyperkaliémie, quant à elle, traduit un taux élevé de potassium dans l’organisme. On l’utilise pour le diagnostic des maladies ci-après :
- L’insuffisance rénale ;
- Les atteintes tubulaires ;
- La maladie d’Addison ;
- L’insuffisance cortico-surrénale ;
- L’hypoaldostéronisme ;
- L’acidocétose diabétique ;
- Les anémies hémolytiques.
Elle peut parfois représenter le signe d’une intoxication aux digitaliques ou des maladies cardiaques comme l’infarctus du myocarde et la fibrillation auriculaire.
Biomarqueurs d’anomalies à usage moins courant

Les principaux biomarqueurs d’anomalies à usage moins courant sont :
- La calciurie ;
- L’amylasémie ;
- Le taux d’acide lactique ;
- La chlorémie ;
- La triglycéridémie ;
- La natrémie.
Voir l’intérêt de ces différents biomarqueurs dans les rubriques suivantes.
Calciurie
La calciurie correspond au taux de calcium présent dans les urines. Au même titre que la calcémie, elle constitue un marqueur biologique pour de nombreuses maladies.
L’hypercalciurie (taux élevé de calcium dans les urines) est généralement corrélée à :
- Une hypercalcémie ;
- Une hyperabsorption du calcium au niveau des intestins ;
- Une anomalie de réabsorption calcique ;
- Une corticothérapie.
Plus rarement, on l’associe également à un certain nombre d’endocrinopathies. Par exemple, l’ostéoporose, l’acromégalie, le phéochromocytome, l’hyperthyroïdie et le syndrome de Cushing.
Les hypocalciuries (taux bas de calciums dans les urines) présentent aussi un véritable intérêt diagnostique. On les utilise principalement pour poser le diagnostic de l’hypocalcémie et de l’insuffisance rénale chronique. Cependant, elles constituent aussi une aide à la recherche d’une ostéomalacie, d’un rachitisme ou d’une alcalose.
Amylasémie
L’amylasémie permet de mesurer la quantité d’amylases présente dans le plasma sanguin. On l’exprime généralement en « unité internationale (UI) » par litre et ses variations permettent l’établissement de plusieurs diagnostics.
Une hyperamylasémie, c’est-à-dire une hausse du taux d’amylase dans le sang, traduit principalement une atteinte du pancréas. Il peut s’agir d’une pancréatite, d’un cancer du pancréas ou de kystes du pancréas. Outre ces atteintes, une hyperamylasémie peut également constituer un marqueur biologique pour les groupes de maladies suivantes :
- Les maladies de glandes salivaires comme les oreillons et les tumeurs dues à l’alcoolisme chronique ;
- Les maladies responsables de douleurs abdominales comme les ulcères perforés et les cholécystites ;
- Les maladies ayant trait au métabolisme de l’amylase comme la macroamylasémie.
À l’instar de l’hyperamylasémie, l’hypoamylasémie (baisse du taux d’amylase dans le sang) présente aussi un intérêt diagnostique. On l’utilise principalement pour rechercher les maladies rénales, les lésions pancréatiques et l’hypertriglycéridémie. Par ailleurs, dans les conditions physiologiques spécifiques comme la grossesse, elle constitue un marqueur de prééclampsie.
Taux d’acide lactique
Le taux d’acide lactique correspond à la concentration d’acide lactique dans le sang veineux. On l’exprime souvent en milligrammes par décilitres de sang et il constitue une aide au diagnostic de diverses affections.
La hausse du taux d’acide lactique dans le sang traduit essentiellement une maladie hépatique. Cependant, elle peut aussi représenter le signe :
- D’une insuffisance respiratoire, ventriculaire ou rénale ;
- D’un arrêt cardiaque ;
- D’une infection grave et étendue (sepsis) ;
- D’une hypoxie (baisse du niveau d’oxygène sanguin) ;
- D’une leucémie ;
- D’une intoxication alcoolique.
Par ailleurs, l’élévation du taux sanguin d’acide lactique peut représenter la conséquence d’une complication du diabète.
Même s’il est possible que l’acide lactique connaisse une baisse, le taux d’acide lactique bas ne revêt généralement aucun caractère pathologique. Pour cela, il ne présente aucun intérêt diagnostique et on l’utilise moins.
Chlorémie
La chlorémie désigne la quantité d’ions « chlorure » présents dans le sang. On l’exprime en millimètre par litre et elle a un intérêt diagnostique.
L’hyperchlorémie (hausse du taux des ions chlorures dans le sang) constitue un marqueur majeur de l’acidose métabolique qui provoque généralement une hypernatrémie. On l’utilise également dans certains cas pour poser le diagnostic des alcaloses respiratoires.
L’hyperchlorémie permet aussi de poser le diagnostic des alcaloses métaboliques et des acidoses respiratoires. Hormis cela, il constitue aussi un signe majeur d’hyponatrémie.
Triglycéridémie
La triglycéridémie correspond à la quantité de triglycérides présents dans le sang. On l’exprime soit en gramme par litre ou soit en millimètre par litre. Seules les variations dues à l’excès de triglycérides présentent un intérêt diagnostique. En effet, l’hypertriglycéridémie permet de diagnostiquer les maladies ci-après :
- La pancréatite aiguë ;
- Le diabète de type 1 et le diabète de type 2 ;
- L’hyperuricémie (hausse de la concentration sanguine d’acide urique) :
- L’insuffisance rénale ;
- L’intolérance aux glucides dans les populations de personnes obèses ;
- L’infarctus du myocarde.
L’hypertriglycéridémie peut, outre ces maladies, permettre également de rechercher des apports importants de sucres et d’alcools.
Natrémie
La natrémie correspond à la concentration des ions « sodium » dans le sang. Elle est généralement exprimée en millimoles par litre et ses variations sont le signe de diverses anomalies.
L’hyponatrémie qui représente une baisse de la concentration du sodium dans le sang permet principalement de diagnostiquer les maladies rénales. Dans ce contexte, il s’agit entre autres de l’insuffisance rénale chronique et de la néphropathie sévère. On l’utilise, cependant, dans le diagnostic d’autres affections. Il y a par exemple :
- L’insuffisance surrénalienne ;
- Le diabète grave ;
- L’ictère cholestatique ;
- L’insuffisance cardiaque ;
- La cirrhose ;
- L’hypothyroïdie ;
- Le syndrome néphrotique.
Beaucoup plus rarement, l’hyponatrémie permet de mettre en évidence les effets diurétiques d’un produit et une condition de potomanie.
L’hypernatrémie (hausse de la concentration du sodium dans le sang) quant à elle traduit généralement un état de déshydratation importante. On l’utilise en tant que marqueur diagnostique des pertes d’eau (en cas de diabète) et des pertes rénales (en cas d’utilisation de diurétiques). Quelquefois, elle permet aussi de rechercher des pertes digestives, des pertes cutanées et un apport important de sodium.
Biomarqueurs d’anomalies à usage rare

Les biomarqueurs d’anomalies à usage quelque peu rare sont :
- Le taux de transaminases ;
- La phosphorémie ;
- Le NT-proBNP ;
- La sidérémie ;
- L’uricémie.
Voir plus d’informations sur ces biomarqueurs dans les sections ci-après.
Taux de transaminases
Le taux de transaminases fait allusion à la concentration de transaminases dans le sang. Il permet de rechercher une hausse ou une baisse de transaminases dans le sang. Les variations à la baisse de transaminases ne présentent aucun intérêt diagnostique. Elles permettent juste de confirmer certaines conditions physiologiques comme la grossesse.
Par contre, les augmentations de taux de transaminases ont un très grand intérêt diagnostique. Elles contribuent au diagnostic d’une panoplie de maladies, notamment :
- L’hépatite virale aiguë. Dans ce cas, l’augmentation des transaminases est précoce et survient avant la phase de jaunisse ;
- L’hépatite toxique et médicamenteuse. Dans ce cas, l’augmentation des transaminases fait suite à l’utilisation de médicaments produits toxiques pour le foie ;
- L’ischémie hépatique aiguë. Dans ce cas, on associe l’augmentation des transaminases à une pathologie cardiaque (trouble du rythme, infarctus du myocarde) ;
- L’obstruction des voies biliaires. Dans ce cas, l’augmentation des transaminases relève d’une faible excrétion de la bile ;
- Les hépatites infectieuses virales. Dans ce cas, l’augmentation des transaminases survient en présence de virus spécifiques (VIH et varicelle-zona).
Hormis ces maladies, les hypertransaminases peuvent également constituer le signe d’une stéatose, d’une hémochromatose et de la maladie de Wilson.
Phosphorémie
La phosphorémie correspond au taux de phosphore présent dans le sang. On l’exprime généralement en millimoles par litre. Elle permet d’apprécier les variations de phosphore dans le sang et présente un intérêt diagnostique. L’hyperphosphorémie traduit une hausse du taux de phosphore dans le sang. Elle constitue un marqueur majeur du diabète phosphoré.
L’hypophosphorémie quant à elle traduit une baisse du taux de phosphore dans le sang. Elle permet de poser le diagnostic de problèmes digestifs et constitue aussi un signe d’alcoolisme chronique. Parfois, on l’utilise pour évaluer les propriétés anti-acides de certains produits et médicaments.
NT-proBNP sérique
Le NT-proBNP sérique représente le taux de NT-proBNP, une hormone cardiaque dans le sang. Il est exprimé en nanogrammes par litre (ng/L) et met en évidence les variations de NT-proBNP dans le sang. Le dosage du NT-proBNP sérique présente un intérêt diagnostique et constitue, de ce fait, un marqueur biologique pour différentes maladies.
La hausse du NT-proBNP dans le sang peut permettre de poser le diagnostic des maladies suivantes :
- L’insuffisance cardiaque aiguë ;
- Les valvulopathies ;
- Les pathologies pulmonaires chroniques et aiguës ;
- L’insuffisance rénale ;
- L’hypertrophie ventriculaire gauche secondaire et primitive ;
- Le sepsis ;
- L’arythmie auriculaire.
Dans certains cas, elle constitue une aide au diagnostic de la dysfonction systolique chronique et des ischémies myocardiques aiguës.
La baisse du NT-proBNP ne présente pas grand intérêt biologique. Cependant, elle représente dans plusieurs cas une composante de l’obésité et du diabète 2. On peut donc l’utiliser en association avec d’autres marqueurs biologiques pour diagnostiquer ces conditions pathologiques.
Uricémie
L’uricémie correspond au taux d’acide urique présent dans le sang. On l’exprime en micromoles par litre et elle permet de voir les variations plasmatiques de l’acide urique. Habituellement, on l’utilise à des fins diagnostiques.
L’hyperuricémie est un marqueur majeur de la goutte. Il s’agit d’une maladie métabolique qui touche les articulations. En plus, elle contribue au diagnostic des lithiases rénales. L’hypo-uricémie quant à elle, ne présente pas une valeur diagnostique. Elle permet, toutefois, de mieux surveiller les traitements urico-freinateurs ou urico-éliminateurs.
Autres biomarqueurs d’anomalies
Les autres biomarqueurs d’anomalies comprennent :
- La vitesse de sédimentation ;
- Le taux de troponine ;
- Le couple VS-CRP ;
- Les protéinuries ;
- L’homocystéine ;
- La fructosamine ;
- L’éosinophilie.
Ces différents marqueurs servent selon le cas à diagnostiquer une maladie ou à surveiller son évolution.